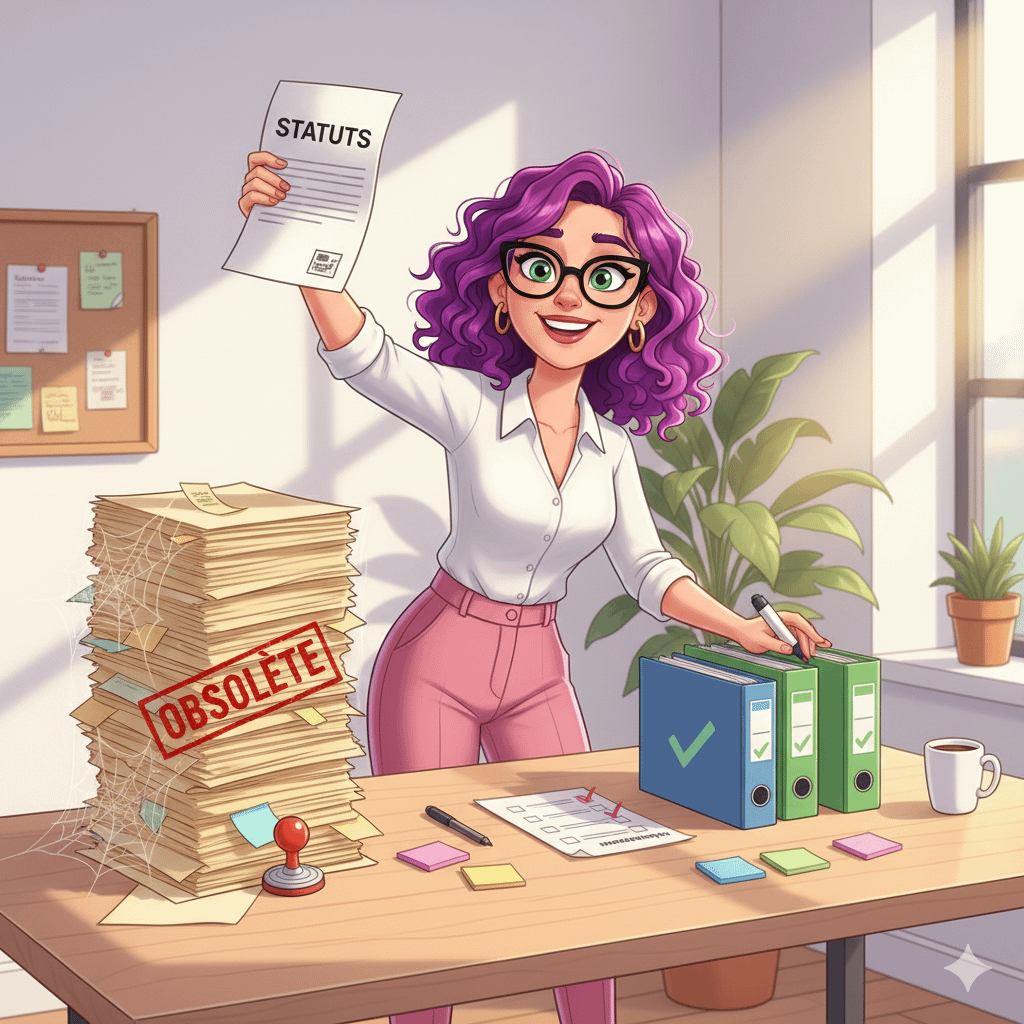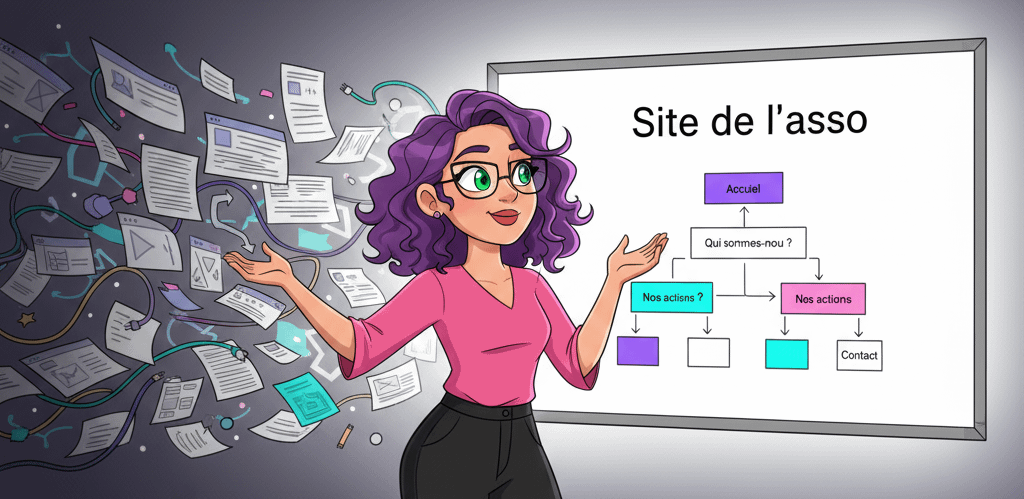Réviser ses statuts tous les ans ? Fausse bonne idée…
Combien d’associations culpabilisent de ne pas avoir révisé leurs statuts depuis 5 ou 10 ans ? Beaucoup trop. Réviser ses statuts n’est pas une obligation légale annuelle. Si vos statuts permettent à votre association de fonctionner, inutile d’y toucher. Mais il existe des situations concrètes où ne pas les réviser vous bloque au quotidien ou vous fait passer à côté d’opportunités importantes. Voici comment savoir si vous êtes concernés. Sommaire Non, vous n’êtes pas obligés de tout réviser chaque année La révision des statuts n’est pas une obligation légale annuelle (contrairement à l’AG ordinaire ou à la tenue des comptes) Modifier les statuts = démarche lourde : AG extraordinaire + déclaration en préfecture Si vos statuts permettent à l’association de fonctionner, laissez-les tranquilles Beaucoup d’associations fonctionnent très bien avec des statuts qui datent de leur création Bon à savoir Statuts ou règlement intérieur : quelle différence ? Avant de réviser vos statuts, posez-vous la question : est-ce que le règlement intérieur ne suffirait pas ? Les statuts définissent le cadre juridique (objet social, gouvernance, AG). Le règlement intérieur précise les modalités pratiques (qui signe quoi, organisation interne) et peut être modifié plus facilement. → Pour bien comprendre la différence et savoir lequel modifier : https://isavouszed.fr/le-reglement-interieur-pour-les-associations-tout-ce-quil-faut-savoir Sauf si vos statuts vous bloquent dans votre quotidien Voici les 5 signaux d’alerte qui montrent que vos statuts vous empêchent vraiment d’avancer : 1. Votre AG ne peut plus se tenir dans les conditions statutaires Le quorum est devenu irréaliste (ex : 50% des 80 membres alors qu’il y a rarement plus de 15 personnes présentes) La limitation du nombre de pouvoirs par personne présente est inadaptée à votre fonctionnement actuel Vous voulez tenir votre AG à distance mais vos statuts ne le prévoient pas (et depuis octobre 2021, c’est obligatoire que ce soit écrit dans les statuts) 2. Vous voulez créer un nouveau rôle de gouvernance Co-présidence, collégialité, vice-président·e, coordinatrice ou coordinateur… Ces rôles n’existent pas dans vos statuts actuels Vous fonctionnez déjà comme ça mais « dans le flou juridique » 3. Votre objet social ne couvre plus ce que vous faites Vos activités ont évolué et ne rentrent plus dans l’objet social initial Vous avez développé de nouvelles actions qui ne sont pas couvertes Votre projet associatif a pivoté mais les statuts sont restés figés 4. Vous passez à côté de financements parce que les termes exacts ne sont pas dans votre objet social C’est le cas le plus concret et le plus frustrant. Un financeur exige qu’un terme précis apparaisse dans votre objet social pour être éligible. Exemple réel : Votre objet social mentionne « lutte contre les discriminations ». Un gros financement s’ouvre mais il exige que « lutte contre les violences » soit explicitement écrit. Résultat : vous êtes inéligible même si vous faites ce travail au quotidien. Solution : réviser vos statuts pour ajouter « lutte contre les violences et les discriminations ». 5. Votre gouvernance actuelle ne correspond plus à ce qui est écrit La composition du bureau ou du CA a changé (nombre de membres, rôles) La durée des mandats ne correspond plus à votre réalité Les conditions de renouvellement sont obsolètes Quand il vaut mieux NE PAS réviser (même si vous avez identifié un problème) Attendez avant de lancer une révision si : 1. Vous êtes en pleine crise interne ou conflit de gouvernance Réviser les statuts = rouvrir des négociations et potentiellement cristalliser des tensions. Mieux vaut stabiliser d’abord. 2. Vous n’avez pas l’énergie collective pour mener le chantier Une révision bien faite demande du temps et de l’adhésion. Si vous êtes en période de creux d’énergie, reportez. 3. Une solution temporaire via le règlement intérieur peut suffire Si le problème peut être contourné ou géré par le règlement intérieur commencez par là. Vous réviserez les statuts plus tard si vraiment nécessaire. Comment réviser sans tout casser La méthode minimaliste : Étape 1 : Lister uniquement ce qui bloque aujourd’hui Pas de refonte totale « par principe ». Identifiez les 2-3 points qui vous empêchent concrètement d’avancer. Étape 2 : Créer l’adhésion au conseil d’administration Avant de lancer un groupe de travail, assurez-vous que le CA est aligné sur le besoin de révision. Sinon, vous allez perdre du temps et créer des frustrations. Étape 3 : Groupe de travail ciblé 2-3 réunions maximum. Focus sur les articles à modifier uniquement. Pas de réécriture complète. Étape 4 : Assemblée générale extraordinaire Vérifiez dans vos statuts actuels les modalités de quorum et de vote pour une modification statutaire. Anticipez le nombre de pouvoirs à collecter. Étape 5 : Déclaration en préfecture C’est obligatoire, simple et gratuit. Les nouveaux statuts ne sont opposables juridiquement qu’après cette déclaration. « Combien ça coûte vraiment ? » : En temps : 1 réunion CA pour valider le besoin : 1h30 2-3 réunions groupe de travail : 3h à 4h30 au total 1 AG extraordinaire : 2h Rédaction et déclaration : 2h Total : entre 8h30 et 10h de travail collectif sur 2-3 mois En accompagnement : Vous pouvez vous faire aider par votre réseau territorial (Maisons de la Vie Associative et Citoyenne), d’autres associations qui ont déjà fait la démarche ou par un·e consultant·e spécialisé·e. La check-list pour savoir si vous devez réviser (ou pas) 3 questions simples pour trancher : 1. Est-ce que mes statuts actuels m’empêchent de faire quelque chose d’important ? → Si non : pas besoin de réviser 2. Est-ce que le règlement intérieur peut régler le problème ? → Si oui : pas besoin de toucher aux statuts 3. Est-ce que j’ai l’énergie collective pour mener cette démarche maintenant ? → Si non : reporter la révision Réviser vos statuts n’est ni une obligation annuelle, ni une corvée à faire « parce qu’il faut ». C’est un outil de gouvernance à activer uniquement quand vos statuts vous bloquent concrètement. Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Et si vous devez réviser, faites-le de façon ciblée et pragmatique. Si vous avez besoin d’aide pour améliorer votre organisation, un seul réflexe : prenez rendez-vous ! Je vous offre … Lire la suite