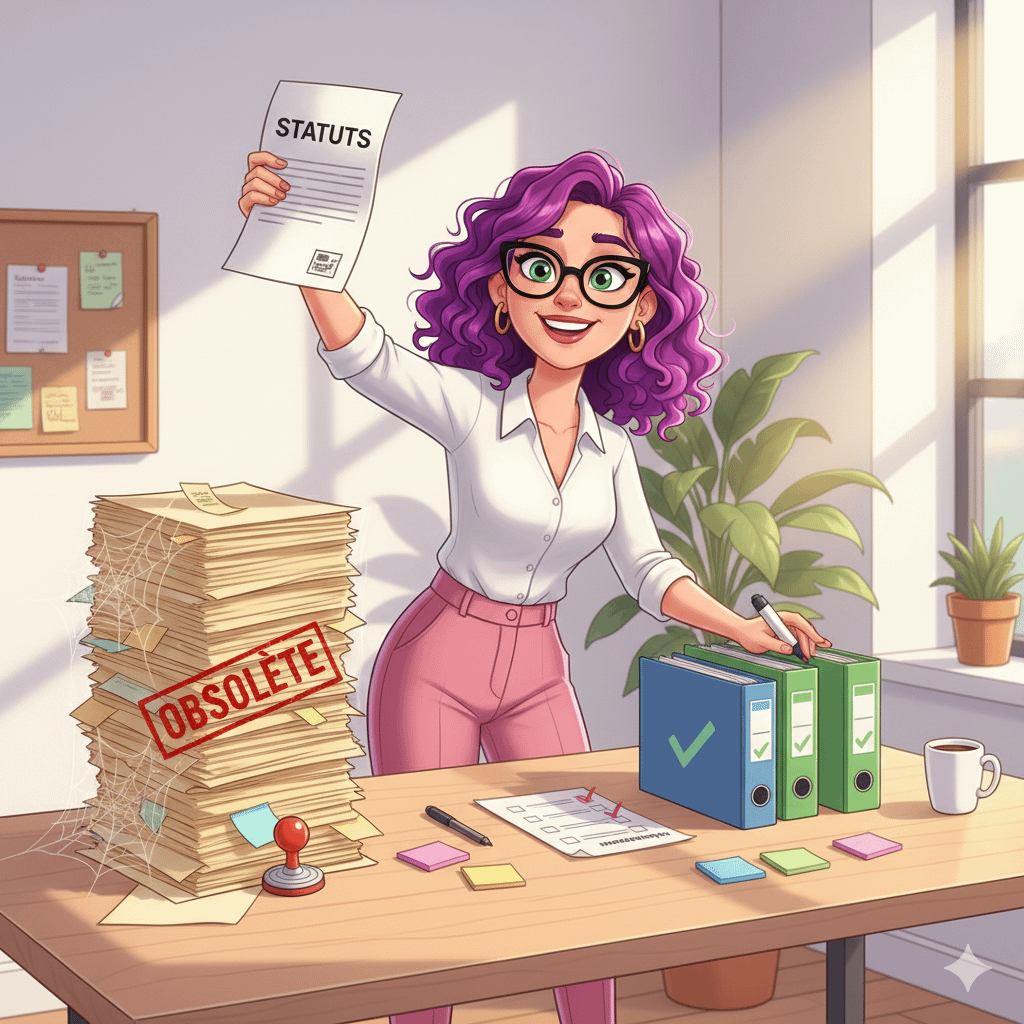Quiz gouvernance : du test à l’action
Avant de commencer la lecture de cet article, faites le quiz « Quel type de gouvernance associative est la vôtre ? » En 8 questions, vous obtiendrez un premier miroir de votre façon de fonctionner : gouvernance centralisée, participative cadrée, diffuse ou en transition. Vous venez de terminer le quiz ? Huit questions, quelques minutes et un profil qui ressort. Peut-être que ce profil vous ressemble beaucoup. Peut-être qu’il vous surprend. Peut-être qu’il confirme ce que vous saviez déjà sans oser le nommer. Mais une fois le résultat affiché, la vraie question arrive : qu’est-ce qu’on en fait maintenant ? Ce quiz n’est pas une sentence. C’est un point de départ pour ouvrir la discussion avec votre bureau, votre conseil d’administration ou votre équipe salariée. Pour nommer ce qui fonctionne bien, ce qui coince et choisir ensemble un premier pas réaliste. Dans cet article, je vous propose un mode d’emploi pour transformer ce diagnostic rapide en levier d’action concrète. Sommaire Un quiz, et après ? Décrypter ce que révèlent vos réponses Le quiz vous a attribué un profil dominant parmi quatre possibles : gouvernance centralisée, participative cadrée, diffuse ou floue ou en transition. Ce profil ne décrit pas qui vous êtes, mais comment vous fonctionnez aujourd’hui, le plus souvent, dans votre manière de décider, d’informer et d’organiser la gouvernance. Il ne s’agit pas d’un verdict. Aucun profil n’est « bon » ou « mauvais » dans l’absolu. Chaque type de gouvernance a ses forces et ses limites, selon le contexte, l’histoire de l’association et l’équipe en place. Vous pouvez aussi avoir des pratiques différentes selon les sujets : finances bien cadrées, communication plus floue, décisions stratégiques centralisées mais vie associative participative. C’est normal. Le quiz donne une tendance dominante, pas une case figée. Le quiz met des mots sur des habitudes que vous avez peut-être déjà ressenties sans savoir comment les nommer. Il ouvre la porte à une conversation nécessaire : celle qui permet de décider ensemble comment vous voulez fonctionner demain. À retenir Un quiz ne remplace pas un audit de gouvernance approfondi. Mais c’est un excellent outil pour ouvrir la discussion et choisir un premier pas réaliste, sans attendre d’avoir tout cassé pour reconstruire. Les quatre profils de gouvernance : où vous reconnaissez-vous ? Profil A : Gouvernance centralisée Une grande partie des décisions et des informations passe par un petit nombre de personnes clés. C’est souvent ce qui a permis à l’association de tenir jusqu’ici, surtout quand il fallait aller vite, trancher sans attendre ou faire face à une urgence. Mais cette organisation peut devenir fragile à mesure que les projets se multiplient, que les obligations administratives s’alourdissent ou que les interlocuteurs extérieurs augmentent. Les personnes qui portent tout risquent l’épuisement. Les autres membres du bureau ou du CA peuvent se sentir tenus à l’écart, par manque d’information ou par manque de place pour contribuer. Ce profil est fréquent dans les associations jeunes ou dans celles qui traversent une phase de croissance rapide avec peu de ressources humaines. Profil B : Gouvernance participative cadrée Vous avez posé des bases solides : les décisions importantes sont discutées, le cadre est plutôt clair et l’information circule globalement bien. La participation ne veut pas dire « parler de tout tout le temps ». Elle signifie que chacun sait à quels moments et comment il peut contribuer. Les rôles sont identifiés (qui est référent finances, communication, partenariats), les réunions sont préparées et les décisions sont notées quelque part. Ce profil est souvent le résultat d’un travail progressif de structuration. Il demande de l’entretien pour ne pas se dégrader avec le temps, surtout en cas de renouvellement des équipes ou de changement d’échelle. Profil C : Gouvernance diffuse ou floue L’envie de faire ensemble est là mais les règles du jeu ne sont pas toujours explicites. Les décisions se construisent au fil des échanges, dans les mails, les messageries, les couloirs, sans qu’on sache toujours quand elles sont prises ni où elles sont notées. Résultat : des discussions qui reviennent souvent, des malentendus et parfois une impression de tourner en rond. Certaines personnes se sentent en retard d’information. D’autres prennent des initiatives sans savoir si elles en ont la légitimité. Ce profil est fréquent dans les associations qui privilégient l’horizontalité et la convivialité mais qui n’ont pas encore formalisé leurs processus de décision. Profil D : Gouvernance en transition Vous avez déjà pris conscience que vos façons de faire ne suffisent plus et vous avez commencé à bouger : nouveaux outils, nouveaux temps d’échange, nouveaux réflexes. C’est une phase parfois inconfortable parce que tout n’est pas encore aligné. Les anciennes habitudes reviennent vite. Certaines personnes adhèrent aux changements, d’autres résistent. Vous tâtonnez, vous testez, vous ajustez. Mais c’est une phase précieuse, parce qu’elle permet de construire une gouvernance plus équilibrée, qui tiendra mieux dans la durée et qui s’adaptera mieux aux évolutions futures de l’association. Transformer le quiz en conversation de gouvernance Une fois le profil identifié, l’étape suivante consiste à en parler. Pas pour juger, ni pour chercher des responsables mais pour clarifier ensemble ce qui se passe aujourd’hui et ce que vous voulez faire évoluer. Vous pouvez commencer par faire le quiz en solo pour vous familiariser avec vos propres réponses. Puis, si vous le souhaitez, proposer à d’autres membres du bureau ou du CA de le faire également pour comparer les résultats en équipe. C’est souvent en comparant les profils obtenus qu’on mesure les écarts de perception sur la gouvernance. Concrètement : bloquez 30 à 45 minutes en début de votre prochaine réunion de bureau ou organisez un temps dédié hors urgences si vos réunions habituelles sont déjà surchargées. Voici trois questions simples à poser en équipe, après avoir fait le quiz individuellement ou collectivement. Qu’est-ce qui vous ressemble vraiment dans ce profil ? Commencez par ce qui fait consensus. Quels éléments du profil obtenu correspondent bien à ce que vous vivez au quotidien ? Quelles situations concrètes illustrent ce fonctionnement ? Cette première question permet de valider … Lire la suite